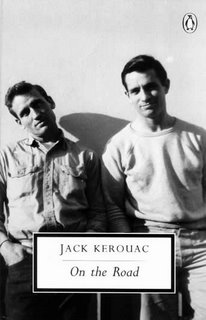
Il y a des livres qui vous suivent tout au long de votre vie, il y a des livres qui vous hantent, des livres qui demandent à être relus à intervalles réguliers, comme les bons disques, ceux qui restent dans votre oreille longtemps après l’écoute et qui un jour se retrouvent sur votre platine parce qu’un matin vous vous êtes réveillés avec un riff dans la tête et qu’il n’y a qu’une chose à faire, chercher dans la pile de CD entassés The idiot d’Iggy Pop ou le Heart of gold de Neil Young, le reste, tout le reste n’ayant qu’une importance relative. Ainsi en est-il de Sur la route de Jack Kerouac, ainsi en est-il des livres de Jack Kerouac, rappelons que Sur la route a été écrit en trois semaines, à un rythme effréné, sur un rouleau de télétype (afin de ne pas perdre de temps à changer les feuilles de la machine à écrire), rythme soutenu grâce à la benzédrine, performance athlétique donc, dopage compris, seven years on the road, three weeks to write... Lire Sur la route vous fait entrer dans une sorte de mouvement perpétuel, vous pourriez, après en avoir lu les 436 pages de l’édition française, revenir au début, et repartir aussitôt : “(...) alors je pense à Dean Moriarty, je pense même au Vieux Dean Moriarty, le père que nous n’avons jamais trouvé, je pense à Dean Moriarty.” / “J’ai connu Dean peu de temps après qu’on ait rompu ma femme et moi. J’étais à peine remis d’une grave maladie etc.” et vous voilà à nouveau embarqués dans le tourbillon, dans le mouvement : “Et il se coucha sur le volant et écrasa l’accélérateur; il était de nouveau dans son élément, c’était visible. On était tous aux anges, on savait tous qu’on laissait derrière nous le désordre et l’absurdité et qu’on remplissait notre noble et unique fonction dans l’espace et dans le temps, j’entends le mouvement.” Rarement romancier aura été aussi avide de performance, trois semaines pour expulser un manuscrit de mille pages (bien sûr, Kerouac, en écrivain consciencieux a retravaillé son texte par la suite, l’éditeur, quant à lui, ne s’est pas privé de tailler dans le vif, notamment les passages explicitement sexuels, voire homosexuels...), une performance qui enterre définitivement les romanciers qui, issus du dix-neuvième siècle, écrivaient encore au pas, tandis que Kerouac fonçait tête baissée au rythme de la révolution des transports, Kerouac qui écrivait aussi vite que Dean Moriarty/Neil Cassady conduisait, Charles Bukowski lui-même ayant fait l’expérience de la folie de Cassady au volant (Journal d’un vieux dégueulasse). Il y a là quelque chose qui évoque la frénésie avec laquelle le jeune John Fante écrivait ses premiers romans dans les années trente, rivé à sa machine à écrire dix à douze heures d’affilée, se déshabillant au fur et à mesure pour finir à poil et en sueur. A chaque écrivain sa généalogie, son panthéon, sa mythologie, Philippe Djian en sait quelque chose, il y a les écrivains qui ont du souffle et il y a les autres, le souffle, le beat, le it : “un tumulte de notes et le saxo piqua le it et tout le monde comprit qu’il l’avait piqué. Dean se prenait la tête à deux mains dans la foule et c’était une foule en délire”. L’écriture comme un long chorus spasmodique, une improvisation à l’instar de la mystique ternaire qui habitait les clubs peuplés de musiciens noirs dans la longue nuit américaine des années 50 : “Des fleurs sacrées flottant dans l’air, tels étaient les visages épuisés dans l’aube de l’Amérique du jazz.” Rien de tel pour pénétrer la scansion qui caractérise l’écriture de Kerouac que de voir et revoir (et revoir...) cette extraordinaire archive qu’est sa participation au Steve Allen Show. Kerouac y lit la fin de Sur la route accompagné par le piano d’Allen et son orchestre, et là ce n’est plus un écrivain qui lit, c’est bien un joueur de sax qui choruse, que ceux qui ont des oreilles entendent, qu’ils se pénètrent de l’exceptionnel placement rythmique de Kerouac, de son phrasé, de sa musicalité : “(...) I think of Dean Moriarty, I - think - of - Dean - Moriarty...”
Richard F. Tabbi, 30 octobre 2006

