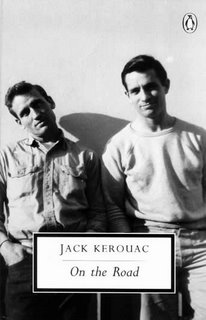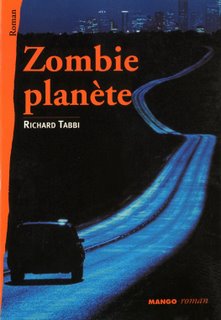Il était une fois un adolescent assommé par les “œuvres” proposées par ses professeurs de français successifs. Des textes sans aucun doute d’une grande valeur littéraire mais dont l’impression reste celle d’hommes et de femmes d’un autre siècle, dont les préoccupations, les actes, et la psychologie, ne parvenaient pas à éveiller la moindre parcelle d’interêt. Quant à l’écriture, n’est-ce pas, difficile d’être sensible à la “qualité” d’un style lorsqu’on a treize ou quatorze ans. Alors quoi ? Peut-être les professeurs de français n’étaient-ils pas aptes à traduire la richesse de tels textes ? Peut-être, tout simplement, le choix des textes lui-même était-il rien moins que judicieux. Pourtant, notre adolescent fut à la fois Sauvé et touché par la Grâce. Le hasard fit qu’il rencontrât au détour de l’interview d’un chanteur à muscles proéminents un certain Blaise Cendrars. Et rien ne fut plus comme avant. Car Cendrars lui révéla que l’on pouvait écrire autrement, que la poésie pouvait avoir une forme et des préoccupations différentes, que l’on pouvait vivre autrement. Et Cendrars, par une étrange contamination amena à la découverte de Céline. Ce fut le choc du Voyage au bout de la nuit. Et logiquement, lorsque l’adolescent devenu jeune homme comprit un peu mieux le fonctionnement du monde, il ne tarda pas à se rendre compte que les frères de Cendrars et de Céline étaient désormais de l’autre côté de l’Atlantique, qu’en France la littérature n’était plus qu’artifices sans substance, bref que la prose pouvait ne pas s’élaborer dans les salons parisiens. Et cela le gagna comme une maladie contagieuse : Henry Miller, Jack Kérouac, Melville, Faulkner, Hemingway, Sallinger, Brautigan, Carver, autant de jalons, autant de découvertes, autant d’appels à la vie, autant de défis. Un jour, ce jeune homme écrirai. Et n’oublierai pas de remercier ceux à qui il doit tant.
On me pardonnera cette longue introduction et le fait que je n’ai pas résisté a la tentation de parler de ma propre expérience. Mais on comprendra mieux lorsqu’on saura que pour moi Philippe Djian fut LE “passeur” qui m’ouvrit les yeux sur la littérature américaine. Mais venons-en à l’essentiel, c’est-à-dire à l’émotion ressentie par Djian lorsqu’il ouvrit L’arrache-cœur de Jérôme-David Sallinger à dix-huit ans. “Il y a cette période de la vie où l’on est fécondé”, et c’est bien de cela qu’il s’agit, fécondation, semence, sang, larmes, tremblements, sont bien les mots qui caractérisent l’étrange processus par lequel beaucoup d’entre nous sont passés entre le moment de l’adolescence et celui de l’âge adulte (on laissera à chacun mettre les bornes propres à chaque période) et qui va déterminer notre rapport à la littérature. Djian précise d’ailleurs justement que la littérature vient bien après. Avant, il s’agit de rien de moins que de “connexion directe avec le firmament.”
Quel est donc ce chemin emprunté par l’auteur de “Vers chez les blancs” ? Plutôt que de chemin, c’est de pente raide, de montagne à gravir qu’il faudrait parler, car après les tribulations d’Holden Caulfield, c’est l’ombre gigantesque du Céline de Mort à crédit qui se présente. Céline, qui est pour Djian le “styliste absolu” : “la puissance phénoménale de Céline soulevait à chaque pas des blocs de roche tout entiers et son souffle aplatissait les forêts autour de lui.” Céline, l’écrivain maudit, celui dont on affiche le portrait au-dessus de son bureau, Céline, qui donne à l’écrivain son statut de hors-la-loi, de lutteur solitaire. Il est un âge où l’on ne résiste pas à la force de certaines images.
L’étape suivante se déroule bien sûr outre Atlantique. À New York, pour tout dire. “Tout homme sain d’esprit devrait posséder une bonne valise. Et lire Cendrars.” Car la poésie est le passage obligé pour tout apprenti écrivain, l’art le plus difficile, celui qui véritablement implique un combat avec la matière. Et surtout, Cendrars, en une synthèse magnifique, réconcilie l’écriture et la vie, écrire, respirer, deviennent une seule et même chose. Il donne aussi la mesure du travail à accomplir : “à partir de ce moment je découvris qu’écrire n’était pas facile. Qu’il ne suffisait pas de voyager et de rouler ses cigarettes d’une seule main pour écrire Les Pâques à New York. Je crois que l’on devient écrivain le jour où l’on ne parvient plus à écrire. Le jour où le moindre mot commence à vous poser problème.”
L’écriture et la vie. Inséparables. Surgit alors Jack Kérouac et son rouleau de papier calque incantatoire, Sur la route. Djian a vingt-quatre ans : “la première phrase trace un sillon sur ma poitrine. C’est une lame qui avance en écartant mes chairs.” Kérouac montre alors comment vivre et pourquoi le style d’un écrivain est nécessairement en relation avec sa vision du monde. Surtout, le passage par le jazz, puis par la musique dite pop, apparaît dans toute sa lumière. Surtout si l’on se souvient de l’extraordinaire créativité des années soixante et soixante-dix dans le domaine musical (depuis, c’est un peu, disons, différent), et si l’on prend conscience de la part croissante de celui-ci dans le bagage culturel de chacun. Alors, comment ne pas comprendre la volonté affichée par Philippe Djian d’écrire un livre qui ressemblerait à une chanson de Lou Reed ? Ceux qui sont incapable de discerner ce qu’il y a d’essentiel dans une telle affirmation passent à côté de l’écriture : style, intonation, mélodie. Autant d’éléments incontournables. On recommandera à certains “stylistes” de réciter leur prose à voix haute, sur un tempo jazzy, cha-bada cha-bada...
“Je pense que c’est à Melville que je dois ce sentiment qu’un personnage n’existe pas tant que le vent n’a pas soufflé dans ses cheveux. Tant qu’il n’a pas éprouvé physiquement la présence du monde qui l’entoure - et le vent, la pluie, le soleil, les rivières ou les montagnes m’ont toujours semblé les plus dignes de foi.”
Tout est dit et on nous conseillera le voyage à Nantucket avant que de commencer à s’immerger dans les aventures de l’équipage du Pequod. Autre jalon important, conscience aigue de la matérialité de chaque élément du décor qui transforme le lecteur en spectateur embarqué sur le fameux navire. La fréquentation des anciens a aussi du bon, pour peu qu’ils sachent nous faire partager le goût du sel et nous effrayer, lorsque les tempêtes soufflent sur l’immensité. En attendant la baleine blanche...
Avec la Crucifixion en rose, Djian dit avoir atteint le point de non-retour dans sa résolution à devenir écrivain. Le souffle terrassant de Miller, la dimension physique du travail, l’exploit “athlétique” le fascinent. Surtout, la pornographie apparaît comme l’arme absolue, “l’élément indispensable à la compréhension du monde”, car “il n’y a pas de pornographie sans vision du monde”. La dimension métaphysique qu’imprime à la sexualité le colosse de Big Sur est toujours d’actualité dans l’étrange société du début du troisième millénaire où l’on n’interdit plus grand’chose dans le domaine de la sexualité, ce qui a pour conséquence la prolifération d’écrits et de films dont on peut légitimiment se demander s’ils visent autre chose que l’indigestion et sa conséquence inévitable, la diarhée(“il n’y a pas de pornographie dans les sex-shops, il n’y a que de la merde”). Reste que Miller demeure le monstre qu’il s’agit d’égaler. Parce que vouloir être écrivain, c’est être un peu fou. Et que le meilleur remède reste la lucidité quant à ses propres insuffisances. Le défi, toujours.
Certes, il y a des auteurs plus complexes que d’autres. Mais peut-être n’est-ce pas la bonne manière - la structure - d’aborder leur œuvre. Alors, faisons confiance à Philippe Djian : “Faulkner agit sur le lecteur par envoûtement”. Y-a-t-il quelque chose à ajouter ? Vous, qui fréquentez aussi Faulkner depuis de longues années et de nombreux livres, auriez-vous trouvé quelque chose de plus juste, de plus définitif ? Relisons donc Tandis que j’agonise et Le bruit et la fureur, et écoutons la voix de William Faulkner, dont on s’étonne qu’il se refuse à parler de son œuvre : “Je suis trop occupé à l’écrire. Il faut qu’elle me plaise à moi et si c’est le cas, je n’ai pas besoin d’en parler. Si elle ne me plaît pas, en parler ne l’améliorera pas puisque le seul moyen de l’améliorer c’est de travailler un peu plus. Je ne suis pas un homme de lettres, je suis un écrivain.” Une profession de foi qui va comme un gant à l’auteur de Lent Dehors.
Dans cette galerie de portraits de géants, il ne manquait qu’Hemingway, Hemingway et sa grande gueule, Hemingway aux innombrables blessures, Hemingway qui s’est fait sauter le caisson avec un fusil de chasse, tandis que certains écrivains meurent dans leur lit ou sur les bancs d’une quelconque académie. Hemingway. Hemingway et le style. Car rien d’autre n’est important, le reste, n’est-ce pas, est bon pour les magazines ou pour les aigris au souffle court (on ne citera personne ici). Hemingway est un grand professeur, Philippe Djian, même s’il s’en défend, l’est aussi : “écrire comme l’on manie la muleta : avec une précision absolue et sans artifices.”
Sur l’ardoise, restent encorent les noms de Richard Brautigan et de Raymond Carver. Richard Brautigan ou la légèreté, ou encore comment faire tenir une tragédie grecque dans un dé à coudre. Richard Brautigan et son extraordinaire sensibilité, Richard Brautigan, qui a dynamité tous les genres, polar, science-fiction etc. Richard Brautigan, cet au-delà de la littérature que l’on ne peut qu’aimer. Et Carver, les nouvelles de Carver, à l’écriture limpide, encore un styliste de l’épure. Celui qui donne à jamais le sens du combat à mener.
Philippe Djian, Ardoise, Paris : Julliard, 2002, 127 p., 15,10 Euros.
Richard F. Tabbi, mars 2002